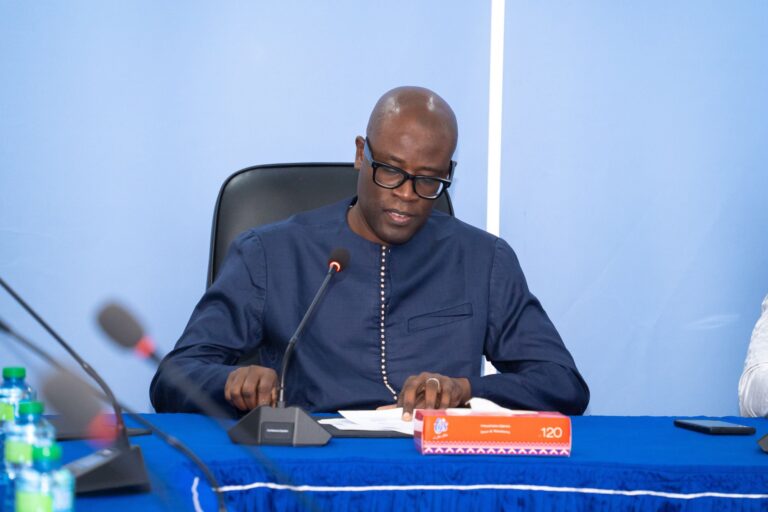Les ressources minérales désignent des concentrations naturelles de matériaux, sous forme liquide, solide ou gazeuse, présentes dans la croûte terrestre en quantité et qualité suffisantes pour permettre une exploitation économique viable. Ces ressources se présentent généralement sous forme de gisements, dont l’exploitabilité dépend de plusieurs paramètres, principalement d’ordre économique. Cependant, ces critères ne sont pas exclusivement financiers. L’exploitabilité d’un gisement est également influencée par des facteurs minéralogiques, géologiques, géographiques et mêmes socio-politiques.
Par M Ousseynou Sokhna, Ingénieur géologue
Définissons d’abord ces quelques termes : minéral, roche, minerai, gîte et gisement.
Un minéral est un corps naturel solide, inorganique, cristallin et homogène, ayant des propriétés physiques et une formule chimique bien définie. Un ensemble d’un ou de plusieurs minéraux constitue une roche. Un minerai est une roche dont on peut extraire avec profit une substance minérale (or par exemple) grâce à la technologie existante et dans les conditions économiques du moment. La notion de minerai est alors à la fois une notion chimique, minéralogique et surtout économique. En effet, toute substance minérale profitable ayant des potentialités économiques constitue un minerai. En guise d’exemple, on peut citer la bauxite qui est un minerai d’aluminium. Un gîte est une concentration anormale (anomalie) d’un élément chimique (ou minéral) donné dans une formation rocheuse. Les gisements sont des gîtes économiquement profitables.
Les facteurs ou paramètres d’exploitabilité d’un gisement.
La valeur d’une concentration de substance minérale, et en particulier son exploitabilité économique, détermine si elle constitue un gîte minier au sens économique du terme ou, au contraire, si elle demeure inexploitable. Cette exploitabilité repose sur plusieurs facteurs. Certains sont géologiques, minéralogiques et géographiques, tandis que d’autres, plus variables dans le temps, relèvent de considérations économiques, techniques et socio-politiques.
- Facteurs de nature minéralogique et géologique
Ces facteurs sont déterminés par la formation et la composition du minerai. Parmi eux, certains, décrits ci-dessous, jouent un rôle essentiel dans l’exploitabilité d’un gisement.
-Facteur de concentration ou teneur de coupure (en métal, métalloïde, minéral etc) : il permet de distinguer le minerai du stérile. La teneur de coupure désigne la concentration minimale d’un élément utile (métal, minéral, métalloïde, etc.) à partir de laquelle l’exploitation devient économiquement viable. En dessous de cette teneur, les coûts d’extraction, de traitement et de commercialisation dépasseraient les revenus générés, rendant ainsi l’exploitation non rentable. Cette teneur dépend de plusieurs paramètres, notamment : le prix du métal ou du minéral sur le marché, les coûts d’extraction, de traitement et de transport, la technologie disponible pour l’enrichissement du minerai, les contraintes environnementales et réglementaires. Par exemple, aux États-Unis, la teneur moyenne des gisements de cuivre exploités était d’environ 3 % en 1880. Entre 1951 et 1956, cette teneur a chuté à 0,8 %, notamment en raison de la hausse du prix du cuivre, rendant ainsi économiquement viables des gisements de plus faible concentration. Il est également important de noter que la valeur estimative du facteur de concentration d’une substance est d’autant plus élevée que cette dernière est rare dans la croûte terrestre. Outre la teneur en élément recherché, la présence d’impuretés peut aussi jouer un rôle déterminant. Dans certains cas, ces impuretés sont constituées de métaux de valeur, présents en trop faible quantité pour justifier à eux seuls une exploitation, mais récupérables comme sous-produits lors de l’extraction du métal principal. Un exemple marquant est celui des gisements d’or du Witwatersrand en Afrique du Sud. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, on y a découvert une teneur d’environ 0,01 % en uranium, bien en dessous de la teneur limite moyenne de 0,1 %. Toutefois, l’uranium étant un élément stratégique, son extraction conjointe à celle de l’or a permis à ces gisements de devenir l’un des premiers producteurs mondiaux d’uranium.
-La composition minéralogique du minerai : elle joue un rôle déterminant dans son exploitation, car elle influence directement le traitement métallurgique à appliquer, qui peut être plus ou moins coûteux. Ainsi, deux minerais de même teneur, mais de natures minéralogiques distinctes, peuvent avoir des valeurs économiques très différentes. Par exemple, la chalcopyrite (CuFeS₂) et la malachite (Cu₂CO₃(OH)₂) sont deux minerais de cuivre. Bien que la malachite contienne un taux de cuivre plus élevé (57,5 % contre 34,5 % pour la chalcopyrite), elle est souvent moins rentable à exploiter en raison de son traitement plus complexe et plus coûteux. En effet, la chalcopyrite, un sulfure de cuivre, est traitée efficacement par flottation, suivie d’un procédé pyrométallurgique (fusion et affinage), qui est bien maîtrisé et adapté aux exploitations industrielles. Tandis que la malachite, un carbonate de cuivre, nécessite généralement une hydrométallurgie impliquant une dissolution à l’acide sulfurique, suivie d’une électrolyse. Ce procédé est souvent plus coûteux en réactifs chimiques et pose des défis en matière de gestion des résidus. Ainsi, même si la malachite présente une teneur en cuivre plus élevée, la chalcopyrite reste économiquement plus intéressante en raison de son traitement moins onéreux et plus adapté aux grandes exploitations minières.
-Les réserves de minerai exploitable : la notion de réserve minérale est complexe et ne doit pas être confondue avec la concentration ou la teneur d’un élément exploitable (métal, minéral, etc.). De manière générale, les réserves d’un gisement correspondent à la quantité de métal ou de minéral pouvant être récupérée dans l’exploitation, en fonction des conditions technologiques et économiques du moment. Par exemple, un gisement d’or peut afficher une concentration en or de 50 %, mais avec la technologie actuelle, seule une récupération de 36 % est possible. Ainsi, la réserve ne correspond pas à la totalité du métal contenu dans le gisement, mais à la fraction réellement exploitable. Classiquement, on distingue trois types de réserves décrites ci-après. Les réserves à vue : constituées de massifs de minerai entièrement délimités par les travaux de recherche ou d’exploitation. Les réserves probables : correspondant à des massifs partiellement délimités, pour lesquels des incertitudes subsistent quant aux dimensions exactes et à la teneur exploitable. Les réserves possibles : reposant sur des indices géologiques et minéralogiques, mais dont l’existence n’a pas encore été confirmée par des travaux d’exploration détaillés. La notion de réserve est relativement simple à définir lorsqu’il s’agit d’une masse minéralisée bien délimitée, comme un filon séparé nettement de la roche encaissante stérile. En revanche, cette définition devient plus complexe pour des gisements diffus, où les limites de la minéralisation sont progressives et floues, rendant l’évaluation plus difficile.
-La géologie du gisement joue un rôle déterminant dans son exploitabilité, notamment en raison de plusieurs facteurs clés tels que la profondeur du gisement et accessibilité, la structure du gîte et impact sur l’exploitation, l’influence des terrains encaissants et sus-jacents… La profondeur du gisement par rapport à la surface influence directement le coût de l’exploitation. Plus un gîte est profond, plus les coûts d’extraction augmentent, et au-delà d’une certaine profondeur, l’exploitation devient soit techniquement difficile, soit économiquement non viable. Plusieurs contraintes sont aussi liées à la profondeur. Par exemple, l’augmentation de la température avec la profondeur rend l’atmosphère minière irrespirable, nécessitant des installations coûteuses de ventilation et de réfrigération. La limite d’exploitabilité dépend aussi de la valeur du minerai : plus un minerai est précieux, plus la profondeur à laquelle il peut être exploité est grande. Par exemple, pour des matériaux à faible valeur comme l’ardoise ou certaines roches industrielles, la profondeur d’exploitation est généralement faible, voire quasi nulle. À l’inverse, pour les métaux précieux comme l’or, l’exploitation peut atteindre plusieurs kilomètres sous terre. La morphologie du gisement est également un facteur clé : un filon épais a plus de valeur qu’un faisceau de filons minces, même si la somme de leur épaisseur est équivalente. En effet, dans le cas de filons minces, la proportion de stérile à extraire est plus élevée, ce qui augmente les coûts d’exploitation. La nature des terrains encaissants peut également influencer le coût et la faisabilité de l’exploitation d’un gisement. Des terrains mal consolidés ou friables nécessitent des travaux de soutènement importants pour garantir la sécurité des mines, ce qui alourdit les coûts. La présence de couches aquifères peut aussi compliquer considérablement l’extraction. Une gestion inadaptée des eaux souterraines peut engendrer des problèmes d’exhaure (évacuation de l’eau), voire mener à l’abandon de la mine si les coûts deviennent prohibitifs.
- Facteurs géographiques
Les facteurs géographiques influencent également l’exploitabilité d’un gisement. Ils relèvent à la fois de la géographie physique (climat, accessibilité) et de la géographie économique (infrastructures, proximité des marchés).
-Le climat joue un rôle variable selon le type d’exploitation. Pour les mines à ciel ouvert, son impact est généralement limité, bien que des conditions extrêmes (tempêtes, inondations, sécheresses) puissent perturber l’activité. Pour les mines souterraines, il est plus significatif car une partie des installations se trouve en surface (machine d’extraction, ateliers, usine de concentration). Un climat rigoureux peut ralentir ou même suspendre l’exploitation pendant plusieurs mois, entraînant l’immobilisation de machines coûteuses et leur détérioration due aux intempéries. Le climat affecte aussi le traitement du minerai. La majorité des mines sont associées à une usine de concentration, où le traitement repose souvent sur des techniques nécessitant de grandes quantités d’eau (flottation, table à secousses, etc.). Dans les régions arides, le manque d’eau devient un obstacle majeur à l’exploitation. Exemple : l’extraction du zircon exige un apport massif en eau pour les techniques de récupération. Dans des zones désertiques, l’absence d’une ressource hydrique suffisante peut rendre le traitement économiquement non viable.
-La localisation géographique du gisement est un facteur déterminant pour sa rentabilité. Deux aspects sont particulièrement importants : la distance entre la mine et l’utilisateur final (usine métallurgique, centre de transformation, port d’exportation) et l’accessibilité aux infrastructures de transport. Plus cette distance est grande, plus les coûts de transport augmentent. Une mine isolée ou enclavée nécessitera la construction de chemins de fer, routes, télébennes, ports, ce qui représente des investissements lourds pouvant grever la rentabilité du projet. Un cas d’école est celui du gisement de fer de Falémé au Sénégal. Malgré d’importantes réserves, son exploitation reste limitée en raison de son enclavement, qui entraîne des coûts d’infrastructure exorbitants (notamment la nécessité de construire un réseau ferroviaire pour acheminer le minerai vers les centres de transformation ou les ports).
- Facteurs socio-politiques
Les facteurs socio-politiques jouent un rôle essentiel dans l’exploitabilité d’un gisement. Ils englobent principalement la politique fiscale, la stabilité sociale et politique, le coût de la main-d’œuvre, ainsi que le prix des concessions et des terrains.
-Politique fiscale et attractivité pour les investisseurs : une fiscalité allégée et des incentives économiques (exonérations fiscales, facilités d’investissement) favorisent l’attrait des compagnies minières et des investisseurs pour l’exploration et l’exploitation de gisements. À l’inverse, une taxation excessive peut freiner le développement de projets miniers.
-La stabilité sociale et politique est un élément déterminant dans le choix d’investir dans un gisement. Les investisseurs évitent généralement les régions sujettes à des conflits armés, émeutes, ou instabilités politiques, qui pourraient compromettre l’exploitation des gisements. L’extraction de ressources exige des investissements lourds sur le long terme, et une incertitude politique ou sociale augmente considérablement les risques financiers. Un excellent exemple est le Canada, particulièrement les provinces du Québec et de l’Ontario, qui possèdent un secteur minier très développé grâce à une combinaison de politique fiscale avantageuse et de stabilité socio-politique.
-Le coût et la disponibilité de la main-d’œuvre jouent également un rôle dans l’exploitabilité des ressources minérales. L’industrie minière reste fortement dépendante de la main-d’œuvre, bien que l’automatisation ait réduit cet impact dans certaines régions. Dans certains pays en développement, de petits gisements peuvent être exploités de manière artisanale avec une main-d’œuvre locale peu coûteuse. En revanche, l’exploitation de grands gisements nécessite une main-d’œuvre qualifiée (ouvriers, techniciens, ingénieurs), ce qui implique des investissements dans des bases de vie, infrastructures routières et services pour le personnel.
-Coût des concessions et disponibilité des terrains : l’achat ou la concession des terrains où se situe le gisement influence directement la rentabilité du projet. Un gisement situé sous une région densément peuplée présente plusieurs défis entraine des coûts élevés du terrain pour les infrastructures minières. La gestion des stériles aussi peut, dans certain cas, être un problème majeur. En effet, les déchets miniers ne pouvant être stockés à proximité, il faut investir dans des solutions alternatives coûteuses (transport des stériles à distance, remblayage souterrain, etc.). En outre, la délocalisation des populations peut constituer un obstacle : si des villages sont situés dans la zone du permis minier, l’entreprise doit prévoir des plans de relocalisation qui peuvent être financièrement et socialement complexes.
Oui, c’est exactement ça ! L’exploitabilité d’un gisement repose sur une combinaison de facteurs techniques, économiques, géographiques et politiques, chacun ayant un impact direct sur la rentabilité et la viabilité du projet minier. Cependant, l’incertitude demeure une constante dans le secteur minier. Même si une étude de faisabilité est bien menée, des facteurs imprévus comme : les fluctuations des prix des métaux, les catastrophes naturelles, les changements réglementaires ou fiscaux, les problèmes environnementaux ou sociaux etc., peuvent rendre une exploitation non rentable ou même la stopper complètement. C’est pour cela que les investisseurs et les compagnies minières adoptent des stratégies de gestion des risques, en diversifiant leurs actifs, en investissant dans des technologies plus efficaces et en menant des études approfondies avant l’exploitation.
Yanda Sow